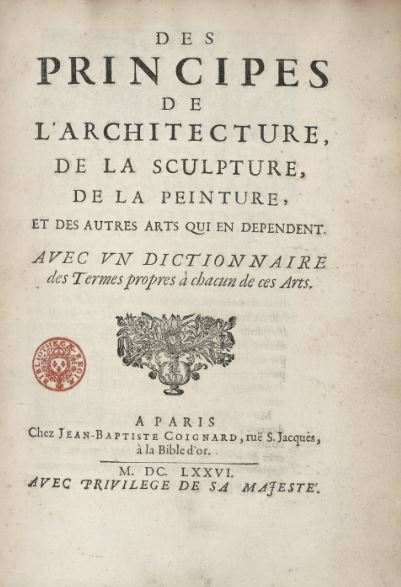FÉLIBIEN, André, Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts, Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1676.
Le travail lexicographique entrepris par Félibien se traduit par l’appropriation du langage spécifique employé par les artistes, leur jargon : « Je me suis particulierement attaché à l’usage [des mots] de ceux qui travaillent, jugeant qu’il doit prevaloir sur toutes sortes de regles, & sur la raison mesme » (Préface, n.p.). C’est aussi la défense du français comme langue de l’art : « Car si dans les Arts dont il est parlé icy, il y a plusieurs mots qui tirent leur origine du grec, du latin, ou de quelques autres langues estrangeres, il y en a bien davantage qui sont tout à fait françois, & qui mesme sont formez par les Ouvriers, & apportez de differens pays ; les uns tels qu’ils ont esté trouvez dans leur commencement, les autres corrompus. Ainsi il se rencontre que dans Paris un mesme mot se prononce en plusieurs manieres, & qu’un mesme outil a differens noms ; parce que ceux qui s’en servent sont nez dans differentes Provinces » (Préface, n.p.).
Les définitions proposées par Félibien concernent à la fois des noms des verbes et des adjectifs et comportent parfois seulement des exemples lui permettant d’illustrer le mot. Si le texte des « principes » regroupe les notions les plus complexes de manière développée, la partie dictionnaire fixe en revanche de façon très synthétique des termes pouvant être expliqués dans les « principes ».
Matthieu Lett et Marianne Freyssinet
Dedication
Jean-Jules-Armand Colbert
Table des matières at n.p.
Épître(s) at n.p.
Préface at n.p.
Privilèges at n.p.
Avertissement at 781
Additions et corrections at 781
FÉLIBIEN, André, Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Par André Félibien. Seconde Édition, Paris, Veuve et fils de Jean-Baptiste Coignard, 1690.
FÉLIBIEN, André, Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Par M. Félibien, Secretaire de l’Academie des Sciences, & Historiographe des Bastimens du Roy. Troisième édition, Paris, Veuve et fils de Jean-Baptiste Coignard, 1697.
FÉLIBIEN, André, Des Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un Dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Par M. Félibien, Secretaire de l’Academie des Sciences, & Historiographe des Bastimens du Roy. Troisième Édition, Paris, Veuve et fils de Jean-Baptiste Coignard, 1699.
FÉLIBIEN, André, Des Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un Dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Par M. Félibien, Secretaire de l’Academie des Sciences, & Historiographe des Bastimens du Roy. Troisième Édition, Farnborough, Gregg Press, 1966.
VERBRAEKEN, René, « André Félibien et le vocabulaire artistique en France au XVIIe siècle », dans VERBRAEKEN, René (éd.), Termes de couleur et lexicographie artistique : recueil d’essais suivi de quelques articles sur la critique d’art, Paris, Éd. du Panthéon, 1997, p. 81-93.
GRIENER, Pascal et HURLEY, Cecilia, « Une norme en transformation. La systématique du vocabulaire artistique au XVIIIe siècle », dans GAEHTGENS, Thomas W. (éd.), L'art et les normes sociales au XVIIIe siècle, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2005, p. 3-14.
GERMER, Stefan, Art, pouvoir, discours : la carrière intellectuelle d'André Félibien dans la France de Louis XIV, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2016.
FILTERS
QUOTATIONS
On trouvera encore plusieurs mots que l’on a employez, qui ne sont point dans l’usage ordinaire, comme par exemple le mot de tendresse, dont l’on ne se sert que moralement pour exprimer les sentiments du cœur : Cependant parmy les Peintres & les Sculpteurs, ce mot est opposé à seicheresse, & l’on dit qu’un tableau est peint avec beaucoup de tendresse, & qu’une statuë de marbre est travaillée avec beaucoup de tendresse. On dit mesme la dureté du marbre ou d’une pierre, ou sa tendresse ; parce qu’on ne peut point opposer en cet endroit le mot de mol à celuy de dur ; & je ne croy pas mesme qu’on puisse blasmer cette maniere de parler, quoy qu’extraordinaire, puisqu’elle n’a rien de barbare, & qui ne signifie assez bien ce que l’on veut dire.
Un des plus grands avantages que l’Art de Portraire ait receu, pour eterniser ses Ouvrages, est la Graveure sur le Bois, & sur le Cuivre, par le moyen de laquelle, on tire un grand nombre d’Estampes, qui multiplient presque à l’infiny un mesme Dessein, & font voir en differens lieux la pensée d’un Ouvrier, qui auparavent n’estoit connuë que par le seul travail qui sortoit de ses mains.
Félibien différencie gravure et estampe, c’est-à-dire la technique et l’œuvre matérielle. La notion de gravure est associée à celle de dessein, comme pensée.
Conceptual field(s)
Félibien différencie ici gravure et estampe, c’est-à-dire la technique et l’œuvre matérielle. La notion de gravure est associée à celle de dessein, comme pensée.
Conceptual field(s)
Félibien différencie ici gravure et estampe, c’est-à-dire la technique et l’œuvre matérielle. La notion de gravure est associée à celle de dessein, comme pensée.
Conceptual field(s)
Un certain Hugo de Carpi inventa une maniere de Graver en Bois par le moyen de laquelle les Estampes paraissent comme lavées de clair-obscur. Il faisoit pour cet effet trois sortes de Planches d’un mesme dessein, lesquelles se tiroient l’une après l’autre sous la Presse pour Imprimer une mesme Estampe. Elles estoient gravées de telle façon, que l’une servoit pour les jours, & les grandes lumieres ; l’autre pour les demi teintes, & la troisiéme pour les contours et les ombres fortes.
Celle [ndr : manière] qui se fait à l’eau forte, semble plus commode pour les grandes ordonnances, & pour les pieces où l’on veut faire paraistre plus d’art, & de dessein, que de delicatesse, & de douceur.
Ceux qui Gravent sur le Bois commencent par faire preparer une planche de la grandeur, & espaisseur qu’ils desirent, & fort unie du costé qu’on veut graver. L’on prend ordinairement pour cela du bois de poirier, ou du buis : le dernier est meilleur par ce qu’il est plus solide, & moins sujet à estre percé des vers. Sur cette Planche, ils desseignent leur sujet à la plume de la mesme sorte qu’ils veulent qu’il soit imprimé. Ceux qui ne sçavent pas bien desseigner, comme il s’en rencontre assez, se servent du mesme dessein qu’on leur donne, qu’ils collent sur la Planche, avec de la colle faite de bonne farine, d’eau, & d’un peu de vinaigre. Il faut que les traits soient collez contre le bois, & lors que le papier est bien sec, ils le lavent doucement, & avec de l’eau, & le bout du doigt l’ostent peu à peu, en sorte qu’il ne reste plus sur le bois que les traits d’encre qui forment le dessein, lesquels marquent sur la Planche tout ce qui doit estre espargné ; & pour le reste ils le coupent, & l’enlevent délicatement avec des pointes de Canifs bien tranchans, ou de petits Ciselets, ou des Gouges, selon la grandeur, & la delicatesse du travail, car ils n’ont pas besoin d’autres Outils.
Conceptual field(s)
Pour graver sur le Cuivre avec le Burin, il n’est pas non plus necessaire de grands apprests. Quand la Planche qui doit estre de Cuivre rouge est bien polie, & que l’on a desseigné dessus avec la pierre de mine, une pointe, ou autrement, ce que l’on veut representer, il n’est plus besoin que de Burins bien acerez, & de bonne trempe pour graver & donner plus ou moins de force selon le travail que l’on fait, & les Figures que l’on represente.
On a aussi un Outil d’Acier d’environ six pouces de long, dont un des bouts qu’on appelle qu’on appelle Gratoir est formé en triangle, tranchant des trois costez, pour ratisser sur le cuivre, quand il est necessaire : Et l’autre bout qu’on nomme Brunissoir, a la figure d’un cœur dont la pointe est alongée, ronde, & fort mince ; il sert à polir le Cuivre, reparer les fautes, & adoucir les traits. Pour connoistre, & mieux voir ce que l’on fait, on a un Tempon de feustre noircy, dont on frotte la Planche, & dont l’on remplit les traits à mesure que l’on grave. On a aussi un petit Coussinet de cuir, sur lequel on appuye le cuivre en travaillant.
Conceptual field(s)
Quant à la Graveure à l’Eau-forte, il y a plus de sujettion. Il est necessaire que la Planche soit bien polie & bien nette, après quoy on la chauffe sur le feu, on la couvre d’un Vernix sec, ou liquide ; car il y en a de deux façons. Ensuite l’on noircit ce Vernix par le moyen d’une chandelle allumée au dessus de laquelle on met la Planche du costé du Vernix.
Cela estant fait, il n’est plus question que de Calquer son dessein sur cette Planche, ce qui est bien plus facile que pour graver au burin ; car en frottant le dessous du dessein avec de la sanguine, ou autrement, & le posant ensuite sur le cuivre pour le Calquer avec une pointe d’éguille, la sanguine qui est derriere le dessein, marquant aisément sur le Vernix, fait que l’on suit bien mieux dans cette sorte de travail, les mesmes traits du dessein, & qu’on est beaucoup plus correct dans les contours, & les expressions de toutes les Figures. Ce qui est cause que les Peintres qui font graver eux-mesmes leurs Ouvrages, travaillent souvent à former les premiers traits des Figures pour conserver la force, & la beauté du dessein. Aussi dans les pieces faites à l’Eau forte, on y voit plus d’art que dans les autres qui sont gravées au burin, ou quelquefois on se sert aussi de l’Eau-forte pour former legerement les contours des Figures, afin de les avoir plus correctes.
Ce qu’il y a d’avantageux dans la graveure à l’Eau-forte, est que non seulement la maniere en est beaucoup plus expeditive, qu’au burin ; mais le travail en est encore ordinairement plus beau dans les païsages, dont les arbres & les terrasses estant touchées avec plus de facilité, paroissent plus naturelles.
Il est vray aussi qu’il est quelquefois besoin de retoucher au burin certaines parties qui n’ont pas assez de force, ou bien que l’eau-forte n’a pas assez mangées ; car il est mal-aisé que dans une grande Planche toutes les parties viennent à estre penetrées avec une si grande égalité qu’il n’y ait quelque chose à redire.
Il ne suffit pas que le Graveur travaille avec la pointe de son Eguille, ou de son Eschope dans tous les endroits de son Ouvrage avec la force, & la tendresse necessaire à faire paroistre les parties éloignées, & les plus proches. Il faut encore qu’il prenne garde, quand il vient à mettre l’eau-forte sur la Planche, qu’elle ne morde pas également par tout ; ce qu’il se fait avec une mixion d’huile, & de suif de chandelle.
Pour cet effet, il a une espece de quaisse de bois, poissée, contre laquelle il attache sa planche un peu inclinée, & jette l’Eau-forte dessus, en sorte qu’elle n’y fait que couler, & retomber aussi-tost dans un vase de terre qui est dessous. Il prend garde lors que les parties qui ne doivent pas estre si mangées ont assez receu de cette eau, & ostant la planche, il la lave bien avec de l’eau claire qu’il jette dessus, la fait seicher doucement auprés du feu, puis il couvre les parties les plus éloignées, & les hacheures qu’on veut laisser les plus foibles, avec de cette mixtion d’huile & de suif, dont j’ay parlé, afin que l’eau forte n’y penetre pas davantage ; & ainsi couvrante à diverses fois, & autant qu’il veut les endroits qui doivent estre les moins forts, il fait que les Figures qui sont devant, sont toujours lavées de l’eau-forte, qui les penetre, jusques à ce qu’il voye qu’elles sont assez gravées suivant la force qu’il desire leur donner.
L’on se sert de deux sortes de Vernix, l’un que l’on appelle mol, & l’autre dur ; il y a aussi deux sortes d’Eau-forte, l’une d’Affineur, qu’on appelle Eau blanche, & l’autre qu’on nomme de l’Eau verte qui se fait avec du vinaigre, du sel commun, du sel armoniac, & du vert de gris. Celle-cy se coule sur les planches, comme j’ay dit, & l’on peut s’en servir avec les deux vernix. L’autre au contraire n’est bonne que pour le vernix mol, & ne se jette pas comme l’autre, on met la planche sur une table tout à plat, & après l’avoir bordée de cire, on la couvre de cette Eau blanche que l’on tempere plus ou moins avec de l’eau commune.
Au regard des Pointes ou Echopes, dont l’on travaille, l’on prend de grosses ou moyennes éguilles, dont l’on fait les unes en pointes, & les autres plus grosses que l’on coupe d’une maniere qui forme une ovalle, comme les Echopes des Orfevres Ces sortes d’outils que l’on a de plusieurs façons, & de differentes grosseurs, sont les seuls necessaires pour cette maniere de travail. L’on a une Pierre pour les aiguiser, & un gros pinceau de Poil de gris, ou une plume pour servir d’Espousettes, afin d’oster de dessus la planche, les ordures, ou le vernix qui s’enleve à mesure qu’on grave.
Conceptual field(s)
La Peinture est un Art qui par des lignes, & des couleurs represente sur une surface égale & unie tous les objets de la Nature, en sorte qu’il n’y a point de corps que l’on ne reconnoisse. L’Image quelle en fait, soit de plusieurs corps ensemble, ou d’un seul en particulier, s’appelle Tableau, dans lequel il y a trois choses à considerer ; sçavoir la Composition, le Dessein, & le Coloris, qui toutes trois dépendent du raisonnement, & de l’execution, ce qu’on nomme la Theorie, & la Pratique ; le raisonnement est comme le Pere de la Peinture, & l’execution comme la Mere.
Conceptual field(s)
La Composition que quelques-uns nomment aussi Invention, comprend la distribution des Figures dans le Tableau ; le choix des attitudes ; les accomodemens des Draperies ; la convenance des ornemens ; la situation des lieux ; les bastimens ; les païsages ; les diverses expressions des mouvemens du corps, & les passions de l’ame, & enfin tout ce que l’imagination se peut former, & qu’on ne peut pas imiter sur le naturel. [...] Ainsi dans la composition d’une histoire quand les Figures sont bien disposées avec de beaux groupes, & une belle election d’attitudes, selon la necessité du sujet ; que les situations, & le plan des lieux sont conformes à la Nature, & qu’il n’y a rien d’oublié de toutes les choses necessaires à l’expression, on dit que cela est bien inventé.
Conceptual field(s)
Le Dessein a pour objet la figure des corps que l’on represente, & que l’on fait voir tels qu’ils paroissent simplement avec des lignes. Cette partie regarde les Peintres, les Sculpteurs, les Architectes, les Graveurs, & generalement tous les Artisans dont les Ouvrages ont besoin de grace, & de simmetrie.
Le Dessein a pour objet la figure des corps que l’on represente, & que l’on fait voir tels qu’ils paroissent simplement avec des lignes. Cette partie regarde les Peintres, les Sculpteurs, les Architectes, les Graveurs, & generalement tous les Artisans dont les Ouvrages ont besoin de grace, & de simmetrie. Elle demande la connoissance de l’Anatomie qui est la science des os, des muscles, & des nerfs, comme ils paroissent exterieurement dans le corps humain. C’est elle encore qui doit poser les Figures sur un centre & equilibre, soit par leur propre poids, ou par un autre qui leur soit accidentel, pour paroistre fermes dans toutes les actions qu’on veut représenter pour bien imiter les divers mouvemens que la nature peut faire.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Le Coloris a pour objet la couleur, la lumiere & l’ombre ; car c’est en mettant les couleurs qu’on observe l’amitié ou l’antipatie qui est entre elles ; leur union & leur douceur.
Le Coloris a pour objet la couleur, la lumiere & l’ombre ; car c’est en mettant les couleurs qu’on observe l’amitié ou l’antipatie qui est entre elles ; leur union & leur douceur. Qu’on regarde comment il faut donner de la force, du relief, de la fierté, & de la grace aux Tableaux.
Conceptual field(s)
Le Coloris a pour objet la couleur, la lumiere & l’ombre ; car c’est en mettant les couleurs qu’on observe l’amitié ou l’antipatie qui est entre elles ; leur union & leur douceur. Qu’on regarde comment il faut donner de la force, du relief, de la fierté, & de la grace aux Tableaux. Qu’on fait des remarques sur les lumieres plus ou moins evidentes, & en degrez de diminution sur les corps accompagnez de lumieres & d’ombres, selon les accidens du lumineux, du diaphane, de la nature du corps illuminé, de l’aspect de celuy qui regarde, & des reflez en differens degrez.
L’habitude que l’on fait en ces trois principales parties [ndr : la composition, le dessein, le coloris] s’appelle Maniere qui est bonne ou mauvaise, selon qu’elle aura esté plus ou moins pratiquée sur le vray, avec connoissance, & estude ; Et le bon ou mauvais choix qu’on en fait, se nomme bon ou mauvais Goust.
Si la lumiere est bien choisie, pour faire avancer les parties ou les Figures les plus proches, & que cette lumiere soit bien répanduë sur les masses, en sorte qu’elle diminuë peu à peu & avec douceur, & qu’elle finisse, & se termine dans une ombre large, diffuse, legere, & qui enfin devienne comme insensible, & de nulle couleur, alors on dit que cela est de grand relief, qu’il y a bien de la force, que le clair-obscur est bien entendu.
Si ensuite parmy les lumieres, & les ombres l’on y voit les vrayes teintes du naturel ; qu’il s’y rencontre des masses de couleurs, où l’on ait soigneusement observé cette amitié, & cette sympatie qui doit estre entre elles, soit pour les chairs avec les draperies, soit pour les draperies les unes prés des autres ; soit pour les vrayes teintes dans les païsages, en sorte que tout y paroisse si artistiquement lié ensemble qu’on n’y connoisse aucune piece separée, mais qu’il y ait une telle union que tout le Tableau semble avoir esté peint d’une suitte, & d’une mesme pallette de couleurs, on dit alors que cela est bien colorié.
La Grace est une partie toute divine ; que peu de personnes ont eüe, & qu’on ne peut definir qu’en disant, que c’est un agreément de beauté dans la Figure, qui procede d’un certain tour & noblesse d’attitude aisée & propre au sujet, & qui charme les yeux.
Dans ce passage, Félibien condense sa conception de la grâce en la liant à la notion de beauté qui s’applique à la figure et procure un agrément visuel.
Conceptual field(s)
Outre cela il y a certaines elegances qui brillent par endroits dans ces trois parties de la Peinture, comme les figures éclattent dans les parties de la Rhétorique ; ce qui releve, & fait paroistre les ouvrages des plus grands Peintres si fort au dessus des autres. Mais sur tout, il doit y avoir ce qu’on appelle Eurythmie ; c’est à dire une proportion, & une convenance de toutes les parties les unes avec les autres. La Grace est une partie toute divine ; que peu de personnes ont eüe, & qu’on ne peut definir qu’en disant, que c’est un agreément de beauté dans la Figure, qui procede d’un certain tour & noblesse d’attitude aisée & propre au sujet, & qui charme les yeux.
Conceptual field(s)
Dans la Peinture ce qu’on nomme ordinairement Dessein, est une expression apparente, ou une image visible des pensées de l’Esprit, & de ce qu’on s’est premierement formé dans l’imagination. Comme cette Image de nos pensées s’exprime en differentes manieres, les Artisans luy ont donné divers noms, selon quelle est plus ou moins achevée. Ils nomment esquisses, les Desseins qui sont les premieres productions de l’Esprit encore informes, & non arrestées, sinon grossierement avec la plume ou le crayon ; Et ceux dont les contours des figures sont achevez, ils les appellent Desseins ou traits Arrestez.
Cet Art de bien contourner les Figures, est le fondement de la Peinture ; car quand les Figures sont bien Desseignées, il n’est plus question que de donner les jours, & les ombres, & sçavoir appliquer les couleurs selon la nature des corps, ce qui veritablement est encore un grand secret de l’Art ; Mais le dessein sert beaucoup à en découvrir les mystères, & sans luy quelque connoissance que l’on ait de l’effet des lumieres, & des ombres, & de la nature des couleurs, il est impossible de rien faire de parfait.
Conceptual field(s)
Dans la Peinture ce qu’on nomme ordinairement Dessein, est une expression apparente, ou une image visible des pensées de l’Esprit, & de ce qu’on s’est premierement formé dans l’imagination. Comme cette Image de nos pensées s’exprime en differentes manieres, les Artisans luy ont donné divers noms, selon quelle est plus ou moins achevée. Ils nomment esquisses, les Desseins qui sont les premieres productions de l’Esprit encore informes, & non arrestées, sinon grossierement avec la plume ou le crayon ; Et ceux dont les contours des figures sont achevez, ils les appellent Desseins ou traits Arrestez.
Lors qu’on veut exprimer quelque sujet, si l’on ne se sert que du crayon ou de la plume, quoy que l’on acheve l’Ouvrage dans toutes les parties, & qu’on y observe les Jours, & les Ombres, on n’appellera neanmoins cet Ouvrage qu’un dessein, que l’on distinguera seulement par la couleur des crayons, ou par l’encre dont on s’est servy : Les uns employans avec les traits de la plume un peu de Lavis fait avec de l’encre de la Chine, ou le Bistre qui est de la suye bien détrempée ; d’autres de la Sanguine ; d’autres de la Pierre noire, & ainsi chacun à sa fantaisie.
Et l’on ne donne le nom de Peinture à quelque Ouvrage que ce soit que lors qu’on y employe des couleurs broyées à huile ou autrement. Car encore qu’on fasse de fort belles Figures avec des Pastels ou crayons de differentes couleurs, qui font quasi le mesme effet que la Peinture, neanmoins on n’appelle pas cela Peinture, bien que pour mieux exprimer la beauté de ce travail on puisse dire que cela soit bien peint.
Lors qu’on veut exprimer quelque sujet, si l’on ne se sert que du crayon ou de la plume, quoy que l’on acheve l’Ouvrage dans toutes les parties, & qu’on y observe les Jours, & les Ombres, on n’appellera neanmoins cet Ouvrage qu’un dessein, que l’on distinguera seulement par la couleur des crayons, ou par l’encre dont on s’est servy : Les uns employans avec les traits de la plume un peu de Lavis fait avec de l’encre de la Chine, ou le Bistre qui est de la suye bien détrempée ; d’autres de la Sanguine ; d’autres de la Pierre noire, & ainsi chacun à sa fantaisie. Et l’on ne donne le nom de Peinture à quelque Ouvrage que ce soit que lors qu’on y employe des couleurs broyées à huile ou autrement. Car encore qu’on fasse de fort belles Figures avec des Pastels ou crayons de differentes couleurs, qui font quasi le mesme effet que la Peinture, neanmoins on n’appelle pas cela Peinture, bien que pour mieux exprimer la beauté de ce travail on puisse dire que cela soit bien peint.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
De toutes les sortes de Peintures qui se pratiquent aujourd’huy, il est certain que c’est dans celles que l’on fait à Fraisque qu’un excellent Ouvrier peut faire paroistre plus d’Art, & donner davantage de vivacité à son ouvrage ; Mais pour s’en bien acquitter, il faut estre bon Dessignateur, & avoir une grande pratique, & une forte intelligence de ce que l’on fait, autrement l’ouvrage sera pauvre, sec, & désagreable, parce que les couleurs ne se meslent pas comme à huile, ainsi que je diray cy-après.
Ce travail se fait contre les murailles, & les voûtes fraischement enduites de mortier fait de chaux & de sable ; mais il ne faut faire l’enduit qu’à mesure que l’on peint, & n’en preparer qu’autant qu’on en peut peindre en un jour, pendant qu’il est frais & humide.
Avant que de commencer à peindre l’on fait des Cartons, c’est à dire des desseins sur du papier, de la grandeur de l’ouvrage, lesquels on calcque par partie contre le mur, à mesure qu’on travaille, & une demie heure après que l’enduit est fait, bien pressé, & bien polly avec la truelle.
Conceptual field(s)
L’Enduit se fait avec du sable de riviere bien passé au sas ou d’autre bon sable détrempé avec de la chaux vieille esteinte, que quelques-uns passent aussi de crainte qu’il n’y ait quelque petites pierres, comme il arrive souvent quand la chaux n’est pas bonne, assez cuite, & assez esteinte. L’on se sert à Rome de Pozzolane qui est une espece de sable, qu’on tire de terre en faisant des puits.
L’Enduit se fait avec du sable de riviere bien passé au sas ou d’autre bon sable détrempé avec de la chaux vieille esteinte, que quelques-uns passent aussi de crainte qu’il n’y ait quelque petites pierres, comme il arrive souvent quand la chaux n’est pas bonne, assez cuite, & assez esteinte. L’on se sert à Rome de Pozzolane qui est une espece de sable, qu’on tire de terre en faisant des puits. […]
Les Anciens peignoit sur le stuc, & on peut voir dans Vitruve le soin qu’ils prenoient à bien faire les incrustations, ou enduits de leurs bastimens pour les rendre beaux, & durables. Les Peintres modernes ont trouvé neanmoins que les enduits de chaux & de sable estoient plus commodes pour peindre, parce qu’ils ne seichent pas si-tost que le stuc ; & à cause encore qu’estans grisâtres, ils sont plus propres pour coucher les couleurs, qu’un fond aussi blanc qu’est le stuc.
Anciens (les)
Modernes (Les)
VITRUVIUS
Conceptual field(s)
On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy.
Les couleurs qu’on employe sont : [...] L’Ocre jaune est aussi une terre naturelle qui devient rouge quand on la brule.
Le Jaune obscur ou Ocre de Ruth, qui est encore une terre naturelle & limoneuse, se prend aux ruisseaux des mines de fer ; estant calcinée elle reçoit une belle couleur.
Le Jaune de Naples est une espece de crasse qui s’amasse au tour des mines de souffre ; & quoy qu’on s’en serve à fraisque, sa couleur neanmoins n’est pas si bonne que celle qui se fait de terre, ou d’ocre jaune avec le blanc.
Félibien évoque l’emploi du bleu dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du jaune dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du jaune dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du bleu dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du noir dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du noir dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi de l'ocre dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi de l'ocre dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi de l'ocre dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du bleu dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du rouge dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du rouge dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du rouge dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Félibien évoque l’emploi du vert dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy.
Les couleurs qu’on employe sont :
Le Blanc ; il se fait avec de la chaux qui soit esteinte il y ait long-temps, & de la poudre de marbre blanc, presque autant de l’une que de l’autre. Quelquefois il suffit d’une quatriéme partie de poudre de marbre ; cela dépend de la qualité de la chaux, & ne se connoist que par la pratique ; car s’il y a trop de marbre, le blanc noircit.
Félibien évoque ici l’emploi du blanc dans la technique de la fresque.
Conceptual field(s)
Dans cette sorte de travail [ndr : la fresque] on rejette toutes les Couleurs qui sont composées, & artificielles, & la pluspart des mineraux, & l’on ne se sert presque que des terres qui peuvent conserver leur couleur, & la deffendre de la brulure de la chaux, resistant à son sel que Pline nomme son amertume. Et afin que l’ouvrage soit toujours beau, il faut les employer avec promptitude, pendant que l’enduit est humide, & ne retoucher jamais à sec avec des couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs noircissent, & n’ont jamais tant de vivacité, comme quand elles sont mises au premier coup : Mais principalement lors qu’on travaille à l’air, où ce retouché ne vaut rien du tout. On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy.
Les couleurs qu’on employe sont :
Le Blanc ; il se fait avec de la chaux qui soit esteinte il y ait long-temps, & de la poudre de marbre blanc, presque autant de l’une que de l’autre. Quelquefois il suffit d’une quatriéme partie de poudre de marbre ; cela dépend de la qualité de la chaux, & ne se connoist que par la pratique ; car s’il y a trop de marbre, le blanc noircit.
L’Ocre ou Brun-rouge est une terre naturelle.
L’Ocre jaune est aussi une terre naturelle qui devient rouge quand on la brule.
Le Jaune obscur ou Ocre de Ruth, qui est encore une terre naturelle & limoneuse, se prend aux ruisseaux des mines de fer ; estant calcinée elle reçoit une belle couleur.
Le Jaune de Naples est une espece de crasse qui s’amasse au tour des mines de souffre ; & quoy qu’on s’en serve à fraisque, sa couleur neanmoins n’est pas si bonne que celle qui se fait de terre, ou d’ocre jaune avec le blanc.
Le Rouge violet, est une terre naturelle, qui vient d’Angleterre, & qu’on employe au lieu de Lacque. Les Anciens avoient une couleur que nous n’avons pas qui estoit aussi vive que la Lacque. Car j’ay veu à Rome dans les termes de Tite une chambre, où il y avoit encore dans la voute des ornemens de stuc enrichis de filets d’or, d’azur, & d’un rouge qui sembloit de Lacque.
La Terre verte de Veronne en Lombardie, est une terre naturelle qui est fort dure & obscure.
Une autre terre Verte plus claire.
L’Outre-mer, ou Lapis lazuli est une pierre dure & difficile à bien preparer. On la calcine au feu, ensuitte on la casse fort menuë dans un mortier, puis estant bien pilée, on la mesle avec de la Cire, de la Poix raisine, etc. dont on fait comme une pasteque l’on mannie, & qu’on lave dans de l’eau bien nette ; ce qui en sort le premier est tres-fin, & ensuite diminüe de beauté jusques au gravier qui est comme le marc. Cette couleur subsiste, & se conserve plus que pas une autre couleur. Elle se détrempe sur la pallette quand on l'employe avec de l’huille, & ne se broye point. Elle estoit autrefois plus rare qu’apresent, neanmoins, comme elle est toujours chere, on peut l’espargner dans la fraisque, où l’Email fait le mesme effet, principalement pour les Ciels.
L’Email est une couleur bleuë, qui a peu de corps ; l’on s’en sert dans les grands païsages, & subsiste fort bien au grand air.
La Terre d’Ombre est une Terre obscure ; il faut la calciner dans une boëte de fer, si on veut la rendre plus belle, plus brune, & luy donner un plus bel œil.
La Terre de Cologne est un noir roussatre qui est sujet à se décherger, & à rougir.
Le Noir de Terre vient d’Allemagne.
Il y a encore un autre Noir d’Allemagne qui est une Terre naturelle, qui fait un noir bluastre, comme le noir de charbon ; c’est dont les Imprimeurs font leur noir.
L’on se sert encore d’un autre Noir fait de lie de vin brûlée, que les Italiens appellent Felicia di botta.
Toutes ces Couleurs sont les meilleures pour les Fraisques, comme aussi celles qui sont de terres naturelles y sont fort bonnes. On les broye, & on les détrempe avec de l’eau ; avant que de travailler on fait toutes les principales teintes que l’on met separement dans des Godets de terre. Mais il faut sçavoir que toutes les Couleurs s’éclaircissent à mesure que la fraisque vient à seicher, hormis le Rouge violet, appelé par les Italiens Pavonazzo, le brun-rouge, l’Ocre de Rut, & les Noirs, particulierement ceux qui ont passé par le feu.
Dans cette sorte de travail [ndr : la fresque] on rejette toutes les Couleurs qui sont composées, & artificielles, & la pluspart des mineraux, & l’on ne se sert presque que des terres qui peuvent conserver leur couleur, & la deffendre de la brulure de la chaux, resistant à son sel que Pline nomme son amertume. Et afin que l’ouvrage soit toujours beau, il faut les employer avec promptitude, pendant que l’enduit est humide, & ne retoucher jamais à sec avec des couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs noircissent, & n’ont jamais tant de vivacité, comme quand elles sont mises au premier coup : Mais principalement lors qu’on travaille à l’air, où ce retouché ne vaut rien du tout. On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy. [...] Toutes ces Couleurs sont les meilleures pour les Fraisques, comme aussi celles qui sont de terres naturelles y sont fort bonnes. On les broye, & on les détrempe avec de l’eau ; avant que de travailler on fait toutes les principales teintes que l’on met separement dans des Godets de terre. Mais il faut sçavoir que toutes les Couleurs s’éclaircissent à mesure que la fraisque vient à seicher, hormis le Rouge violet, appelé par les Italiens Pavonazzo, le brun-rouge, l’Ocre de Rut, & les Noirs, particulierement ceux qui ont passé par le feu.
Les Peintres ont d’ordinaire une tuile bien seiche & unie, où ils font les épreuves des teintes, dont ils veulent se servir ; car la tuile aspirant, & beuvant aussi-tost tout ce qu’il y a d’humide dans la couleur, & la laissant seiche, on voit l’effet qu’elle doit faire quand elle sera employée.
Avant qu’un Peintre de Flandre nommé Jean Van-Eyck, mais plus connu sous le nom de Jean de Bruge, eût trouvé le secret de peindre en huile, tous les Peintres ne travailloient qu’à Fraisque, & à Trempe, ou Détrempe, comme l’on dit d’ordinaire icy, soit qu’ils peignissent contre les murailles, soit sur des planches de bois, soit d’une autre maniere. Lors qu’ils se servoient de planches, ils y colloient souvent une toille fine, avec de bonne colle pour empescher les ais de se separer, puis mettoient dessus une couche de blanc. Ensuite, ils détrempoient leurs couleurs avec de l’eau, & de la colle, ou bien avec de l’eau & des jaunes d’œuf battus avec de petites branches de figuier, dont le lait se mesle avec les œufs, & de ce mélange ils peignoient leurs tableaux.
Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude. Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.
Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque
Conceptual field(s)
Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude.
Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude. Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.
Conceptual field(s)
Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.
Conceptual field(s)
Quand on veut peindre sur de la Toille, on en choisit qui soit vieille, demy usée, & bien unie. On l’imprime de Blanc de craye ou de plastre broyé avec de la colle de gans ; & lorsque cette imprimeure est seiche, on passe encore une couche de la mesme colle par dessus.
Si l’on veut vernir le Tableau lorsqu’il est finy, il ne faut que le frotter d’un blanc d’œuf bien battu, & après y mettre une couche de vernix, mais cela ne se fait guere, si ce n’est pour les conserver de l’eau ; car le plus grand avantage de la détrempe est de n’avoir point de luisant ; & de ce que toutes les couleurs demeurant mattes, on les voit dans toutes sortes de jours, ce qui ne se rencontre pas aux couleurs à huile, ou lorsqu’il y a un vernix.
Car par ce moyen les couleurs d’un Tableau se conservent long-temps, & reçoivent un lustre, & une union que les anciens ne pouvoient donner à leurs ouvrages quelque vernix dont ils se servissent pour les couvrir. Ce secret qui a esté si long-temps caché ne consiste neanmoins qu’à broyer les couleurs avec de l’huile de noix, ou de l’huile de lin ; Mais il est vray que le travail est bien different de celuy de la fraisque et de la détrempe, parce que l’huile ne seichant pas si promptement, il faut retoucher plusieurs fois son ouvrage. Aussi le Peintre a-t-il davantage de temps pour le bien finir, & il retouche autant qu’il veut à toutes les parties de ses Figures, ce qu’il ne peut faire à fresque ni à détrempe. Il leur donne aussi plus de force, parce que le noir devient beaucoup plus noir, quand il est employé avec de l’huile qu’avec de l’eau ; & toutes les couleurs se meslant mieux ensemble, font un coloris plus doux, plus délicat, & plus agréable, & donnent une union & une tendresse à tout l’ouvrage, qui ne se peut faire dans les autres manieres.
L’on peint à huile contre les murailles, sur le bois, sur la toile, sur les pierres, & sur toutes sortes de metaux.
L’on peint à huile contre les murailles, sur le bois, sur la toile, sur les pierres, & sur toutes sortes de metaux. Il faut en premier lieu preparer les choses sur lesquelles on veut travailler, par une imprimeure, comme disent les ouvriers, qui serve de fond, & rendre la place ou le champ sur lequel on veut peindre bien égal, & bien uny.
Quand on veut peindre contre une muraille, il faut lorsqu’elle est bien seiche y donner deux ou trois couches d’huile toute boüillante ; & cela autant de fois qu’on le juge necessaire, & jusqu’à ce qu’on voye que l’enduit demeure gras, & qu’il n’enboit plus. Après on l’imprime de couleurs sicatives. Pour cela on prend du blanc de craye, de l’ocre rouge, ou d’autres sortes de terres qu’on broye un peu ferme, dont l’on fait une couche sur le mur. Lorsque cette imprimeure est bien seiche, on peut desseigner ce que l’on veut, & peindre ensuite parmy les couleurs, afin de n’estre pas obligé de les vernir par après.
Il y en a qui preparent la muraille d’une autre sorte, afin qu’elle soit plus seiche, & que l’humidité n’en fasse pas détacher les couleurs par escailles, comme il arrive quelquefois à cause de l’huile qui luy resiste, & qui l’empesche de sortir. Il font un Enduit avec de la chaux, & de la poudre de marbre, ou du ciment fait de tuiles bien battuës, lequel ils frottent avec la truelle pour le rendre bien uni, & l’imbibent d’huile de lin, avec une grosse brosse. Ensuite ils preparent une Composition de poix grecque, de mastic, & de gros vernix qu’on fait boüillir ensemble dans un pot de terre, puis avec une brosse, en couvrent la muraille qu’ils frottent avec une truelle chaude, pour estendre & unir mieux cette matiere. Cela fait on imprime tout le mur des couleurs que j’ay dites cy-dessus, avec que de rien desseigner.
D’autres en usent encore d’une autre maniere, ils font leur Enduit avec du mortier de chaux, du ciment de brique, & du sable, & lorsqu’il est bien sec, ils en font un second, avec de la chaux, du ciment bien tassé, & du machefer, ou escume de fer autant de l’un que de l’autre ; tout cela estant bien battu & incorporé ensemble, avec des blans d’œuf, & de l’huile de lin, il s’en fait un Enduit si ferme qu’on ne peut rien faire de meilleur : Mais il faut prendre garde de ne quiter pas l’Enduit pendant que la matiere y est mise tout fraischement, & de la bien estendre avec la Truelle, jusqu’à ce que le mur en soit tout couvert et poly ; car autrement l’enduit se fendroit en plusieurs endroits. Quand il est bien sec on l’imprime de la mesme maniere que j’ay dit.
Pour peindre sur le bois, après l’avoir bien encollé avec la brosse, on y donne d’ordinaire une couche de blanc détrempé avec de la colle, avant que de le couvrir de l’imprimeure à huile, dont j’ay parlé ; Mais il est vray qu’à present l’on se sert beaucoup plus de toile que d’autres choses, principalement pour les grands tableaux ; parce qu’elle est plus commode à transporter que le bois, qui est pesant, & d’ailleurs sujet à se fendre. On choisit du coutil, ou de la toile la plus unie, & lorsqu’elle est bien tenduë sur un chassis, l’on y donne une couche d’eau de colle, & après on passe par dessus une Pierre de ponce pour en oster les nœuds. L’eau de colle sert à coucher tous les petits fils sur la toile, & remplir les petits troux, afin que la couleur ne passe pas au travers. Quand la toile est bien seiche, on l’imprime d’une couleur simple, & qui ne fasse point mourir les autres couleurs, comme du Brun rouge qui est une terre naturelle qui a du corps, & qui subsite, & avec lequel on mesle quelquefois un peu de blanc de plomb, pour le faire plutost seicher. Cette imprimeure se fait aprés que la couleur est broyée avec de l’huile de lin ; & pour la coucher la moins épaisse que l’on peut, on prend un grand couteau propre pour cela. Quand cette couleur est seiche, on passe encore la Pierre de ponce par dessus pour la rendre plus unie ; puis l’on fait, si l’on veut, une seconde imprimeure composée de blanc de plomb, et d’un peu de noir de charbon, pour rendre le fond grisastre, & en l’une ou l’autre des deux manieres on met le moins de couleur que l’on peut, afin que la toile ne casse pas si-tost, & que les couleurs qu’on vient ensuitte à coucher dessus en peigant, se conservent mieux ; Car quand l’on n’imprimeroit point les toiles, & qu’on peindroit tout d’un coup dessus, les couleurs ne s’en porteroient que mieux, & demeureroient plus belles. L’on voit dans quelques Tableaux de Titien, & de Paul Veronese, qu’il observoient d’en faire l’imprimeure à détrempe, sur laquelle ils peignoient ensuitte avec des couleurs à huile ; Ce qui a beaucoup servi à rendre leurs ouvrages plus vifs, & plus frais : parce que l’imprimeure à détrempe attire, & boit l’huile qui est dans les couleurs, & fait qu’elles restent plus belles, l’huile ostant beaucoup de leur vivacité. C’est pourquoy ceux qui veulent que leurs Tableaux demeurent frais employent le moins d’huile qu’ils peuvent, & tiennent leurs couleurs plus fermes y meslant un peu d’huile d’Aspic, qui s’évapore aussi-tost ; mais qui sert à les faire couleur, & qui les rend plus maniables en travaillant. […].
[…] Et mesme quand il est besoin de donner plus de force à un Ouvrage, il faut attendre qu’il soit sec pour le retoucher, si c’est avec des Couleurs capables de nuire aux autres. La pratique fait connoistre cela, & il y a des Peintres qui pourroient faire ces observations, lesquels n’y pensent pas, ne songeant qu’au principal de leur sujet. Cependant c’est une chose assez considerable pour la conservation, & pour la beauté des Tableaux : Car on en a veu qui paroissent sur le chevalet, dont les couleurs n’ont guere duré, & se sont passées & esteintes en peu de temps, à cause que ceux qui travailloient, avoient beaucoup de feu & de boutade, mais qui tourmentoient, comme j’ay dit, les couleurs avec le brosse & le pinceau. Ceux qui peignent avec jugement, les couchent avec moins de precipitation, les mettent plus épaisses, couvrent & recouvrent plusieurs fois leurs carnations, ce que les Peintres appellent bien empaster.
Pour ce qui est d’imprimer d’abord les toiles avec une couche à détrempe, il est vray que cela ne se pratique pas souvent, parce qu’elles peuvent s’escailler, & ne se roullent qu’avec difficulté. C’est pourquoy l’on se contente de leur donner une imprimeure de couleurs à huile. Mais quand la toile est bonne & bien fine, le moins qu’on peut y mettre de couleur pour l’imprimer est toujours le meilleur ; prenant garde, comme j’ay dit, que l’huile, & les couleurs soient bonnes. L’espargne que font ceux qui employent de meschantes couleurs, & de mauvaise huile, & qui mesme se servent de mine pour faire plustost seicher l’imprimeure, est beaucoup dommageable aux Tableaux, & en efface bientost la beauté du coloris.
Toutes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent.
Du Blanc de plomb, qui se tire du plomb que l’on enterre : au bout de plusieurs années il se forme du plomb mesme, des escailles qui changent & deviennent un fort beau blanc. Quoy que ce blanc subsiste en peinture il a toujours une mauvaise qualité ; l’huile pourtant le corrige en le broyant sur la pierre.
De la Ceruse, qui est aussi une roüille de plomb, mais plus grossiere.
Du Massicot jaune & du Massicot blanc, que l’on fait avec du plomb calciné.
Toutes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent.
Du Blanc de plomb, qui se tire du plomb que l’on enterre : au bout de plusieurs années il se forme du plomb mesme, des escailles qui changent & deviennent un fort beau blanc. Quoy que ce blanc subsiste en peinture il a toujours une mauvaise qualité ; l’huile pourtant le corrige en le broyant sur la pierre.
De la Ceruse, qui est aussi une roüille de plomb, mais plus grossiere.
Du Massicot jaune & du Massicot blanc, que l’on fait avec du plomb calciné.
De l’Orpin. Il s’employe sans calciner & calciné. Pour le calciner on le met au feu dans une boëte de fer, ou dans un pot bien bouché ; mais peu de gens en calcinent, & en employent, parce que la fumée en est mortelle, & qu’il est fort dangereux méme de s’en servir.
De la Mine de plomb, qui vient des mines de plomb. On s’en sert peu, parce qu’elle est mauvaise & ennemie des autres couleurs.
Du Cinabre ou Vermillon qui vient des mines de Vif-Argent ; Comme c’est un mineral, il ne subsiste pas à l’air.
De la Laque qui se fait avec de la Cochenille, ou avec de la Bourre d’Escarlatte, ou du bois de Bresil, ou d’autres differens bois. On en fait de plusieurs especes. Cette Couleur ne subsiste pas à l’air.
Des Cendres bleuës, & des Cendres vertes : l’on ne s’en sert guere qu’aux Paysages.
L’on employe aussi de l’Inde, soit à faire des Ciels, soit à faire des Draperies. Quand il est bien employé il se conserve long-temps beau. Il n’y faut pas mattre trop d’huile, mais le coucher un peu brun parce qu’il se décharge. L’on s’en sert à Détrempe avec assez de succez, estant bon à faire des verts.
Du Stil de grun. Il se fait de graine d’Avignon qu’on fait tremper & boüillir, puis on y jette des Cendres de ferment ou du blanc de Craye pour donner corps comme à la Laque, & après cela l’on passe le tout au travers d’un linge fort fin.
Du Noir de fumée, qui est une mauvaise Couleur, mais facile à peindre des Draperies noires.
Du Noir d’os & d’yvoire bruslé, dont Appelle trouva l’invention selon Pline.
Le Vert-de-gris est la peste de toutes les Couleurs & capable de perdre tout un Tableau, s’il en entroit la moindre partie dans l’Imprimure d’une toile : cependant il a une couleur fort belle & agreable. Quelquefois on le calcine pour oster sa malignité, & empescher qu’il ne meure ; mais il est dangereux à calciner aussi-bien que l’Orpin ; & tout purifié qu’il puisse estre, il ne faut l’employer que seul, car il gasteroit les Couleurs avec lesquelles on pourroit le mesler. On en use à cause qu’il seiche beaucoup, & l’on en mesle seulement un peu dans les noirs qui ne seichent jamais seuls. Il faut bien prendre garde à ne pas se servir de pinceaux avec lesquels on ait peint du Vert-de-gris.
Il y a encore d’autres sortes de Couleurs composées dont on ne se sert guere à huile.
Conceptual field(s)
Toutes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent. [...] Des Cendres bleuës, & des Cendres vertes : l’on ne s’en sert guere qu’aux Paysages.
L’on employe aussi de l’Inde, soit à faire des Ciels, soit à faire des Draperies. Quand il est bien employé il se conserve long-temps beau. Il n’y faut pas mattre trop d’huile, mais le coucher un peu brun parce qu’il se décharge. L’on s’en sert à Détrempe avec assez de succez, estant bon à faire des verts.
outes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent. [...] De l’Orpin. Il s’employe sans calciner & calciné. Pour le calciner on le met au feu dans une boëte de fer, ou dans un pot bien bouché ; mais peu de gens en calcinent, & en employent, parce que la fumée en est mortelle, & qu’il est fort dangereux méme de s’en servir.
Quand aux huiles, les meilleures qu’on puisse employer sont celles de Noix & de Lin.
Pour faire couler les Couleurs, & retoucher plus aisément les Tableaux, l’on se sert d’huile d’Aspic, qui fait boire, & oste le luisant d’un tableau. Elle est propre aussi à enlever la crasse, & à nettoyer les tableaux ; mais il faut prendre garde qu’elle n’emporte la Couleur. Elle est faite de fleurs de Lavande.
Il y a une autre huile tirée de la Resine, que les Italiens appellent Aqua di rasa, & nous Huile de Therebentine. Elle est encore bonne à mesler avec l’Outremer & les Emaux, parce qu’elle s’évapore aussi-tost. Lorsqu’on en veut user il n’est pas necessaire qu’il y ait dans la Couleur beaucoup d’autre huile, qui ne sert qu’à la faire jaunir.
L’on employe encore des Huiles siccatives, pour faire que les autres seichent plus promptement. Il s’en fait de plusieurs sortes. Il y en a qui n’est composée que d’Huile de noix qu’on fait boüillir avec de la Litarge d’or & un Oignon entier & pelé, qu’on retire après qu’il a boüilly ; Il sert à dégraisser l’huile & à la rendre plus claire.
On en fait encore d’une autre sorte en faisant boüillir dans de l’Huile de noix de l’Azur en poudre, ou de l’Email. Quand le tout a boüilly, on laisse reposer l’huile, & on en prend le dessus. Elle sert à détremper le Blanc, & les autres Couleurs que l’on veut conserver les plus propres.
Pour du Vernix il s’en fait aussi de diverses manieres, les uns avec de la Therebentine, & le Sandarac ; les autres avec l’Esprit de vin, le Mastic, & la Gomme laque, le Sandarac ou l’Ambre blanc. C’est de ce Vernix dont on se sert pour mettre sur des Miniatures & des Estampes ; on choisit les Gommes les plus blanches.
Lorsqu’on veut avoir un vernix qui seiche promptement, on prend seulement de la Therebentine dans une fiole & on y met autant d’Esprit de vin, puis remuant le tout ensemble, l’on en vernit aussi-tost ce qu’on a besoin.
Conceptual field(s)
Les principaux Outils necessaires aux Peintres sont une Pierre à broyer avec sa Molette. Les pierres de Porphyre ou d’Escaille de mer sont les meilleures. Un Coûteau, une Palette, l’Appuy-main, ou Baguette ; le Chevalet, les Pinceaux, un Pincelier, qui est une boëte de fer blanc ou l’on met de l’huile pour nettoyer les Pinceaux.
On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Il y a encore une autre maniere de peindre de Blanc & de Noir : mais qui ne se fait qu’à Fraisque, & qui se conserve à l’air ; les Italiens la nomment Sgraffitto, qui veut dire Egrastiné, parcequ’en effet ce n’est proprement qu’un Dessein esgratigné, qui se fait de la maniere que je vais dire. On détrempe du mortier de chaux & de sable à l’ordinaire, auquel on donne une Couleur noirastre, en y mettant de la paille bruslée. De ce mortier on fait un enduit bien uny, que l’on couvre d’une couche de blanc de Chaux, ou d’un enduit bien blanc & bien poly : aprés cela on ponce les Cartons dessus pour desseigner ce que l’on veut, & le graver ensuite avec un fer pointu, lequel découvrant l’enduit ou Blanc de chaux, qui cache le premier Enduit composé de Noir, fait que l’ouvrage paroist comme desseigné à la plume & avec du noir. Lorsqu’il est achevé on a coustume de passer sur tout le blanc qui sert de fond une teinte d’eau un peu obscure, pour détacher davantage les Figures, & faire qu’elle paroissent comme celles qu’on lave sur du papier. Mais si l’on ne represente que quelques Grotesques ou Feuillages, on se contente d’ombrer seulement un peu le fond avec cette eau, auprés des contours qui doivent porter cette ombre.
Quant à ceux [ndr : les peintres] qui travaillent de Miniature & sur le veslin, les couleurs qui ont le moins de corps leurs sont les meilleures, & les plus commodes ; ainsi ils se servent avantageusement de Carmin, de belles Laques, & de Verts que l’on fait de jus d’herbes, & de plusieurs sortes de fleurs. Ce travail dans la Peinture est le plus long de tous, & ne se fait qu’avec la pointe du pinceau. Il y a des Peintres qui n’employent que du blanc, & qui pour rehausser font servir le fond du veslin. Les Claires paroissent à mesure que l’on donne de la couleur & de la force aux figures. D’autres avant que de travailler estendent fort legerement sur le veslin une couche de blanc de plomb bien lavé & bien purgé, qu’ils épargnent ensuitte en pointillant, car c’est ainsi qu’on peint en Miniature. Lorsqu’on couche les couleurs à plat sans les pointiller, soit sur le veslin, soit sur le papier ; on appelle cela laver. Les couleurs se détrempent avec de l’eau de Gomme arabique ou de Gomme adragant.
On travaille aussi avec des couleurs claires sur des étoffes de soye, & d’argent, comme on void des Tapisseries du Roy, & d’autres qui sont à l’Hotel de Condé, du dessein de Nicolo. Mais l’on n’a rien fait de mieux sur les étoffes que ce que l’on fait aujourd’huy pour sa Majesté.
Quant à ceux [ndr : les peintres] qui travaillent de Miniature & sur le veslin, les couleurs qui ont le moins de corps leurs sont les meilleures, & les plus commodes ; ainsi ils se servent avantageusement de Carmin, de belles Laques, & de Verts que l’on fait de jus d’herbes, & de plusieurs sortes de fleurs. Ce travail dans la Peinture est le plus long de tous, & ne se fait qu’avec la pointe du pinceau. Il y a des Peintres qui n’employent que du blanc, & qui pour rehausser font servir le fond du veslin. Les Claires paroissent à mesure que l’on donne de la couleur & de la force aux figures. D’autres avant que de travailler estendent fort legerement sur le veslin une couche de blanc de plomb bien lavé & bien purgé, qu’ils épargnent ensuitte en pointillant, car c’est ainsi qu’on peint en Miniature. Lorsqu’on couche les couleurs à plat sans les pointiller, soit sur le veslin, soit sur le papier ; on appelle cela laver. Les couleurs se détrempent avec de l’eau de Gomme arabique ou de Gomme adragant.
Addoucir en terme de Peinture, c’est mesler les Couleurs avec un pinceau qu’on appelle Brosse, qui ne fait pas de pointe, & qui est ou de poil de porc ou de blereau, ou de chien, ou de quelqu’autre animal.
On addoucit aussi les Desseins lavez, & faits à la plume, en affoiblissant la teinte. On addoucit encore les traits d’un visage ou autre chose en les marquant moins. L’on appelle encore addoucir lorsqu’en changeant les traits on donne plus de douceur à l’air d’un visage qui avoit quelque chose de rude.
Addoucissement. Est lors que les couleurs sont bien noyées les unes avec les autres, que les traits ne sont pas tranchez, & qu’il n’y a rien de rude.
Air en terme de Peinture, l’on dit de beaux airs de teste. Le Guide donne de beaux airs de teste à ses Figures. Dans les ouvrages de Raphaël les airs de teste y sont admirables, c’est-à-dire les visages.
Air. On dit qu’il y a de l’air dans un Tableau, lorsque la couleur de tous les corps est diminuée selon les differens degrez d’éloignement ; cette diminution s’appelle la perspective aërienne.
Amitié des couleurs, les Peintres expriment par ce mot la convenance que les couleurs ont les unes auprés des autres, & le bel effet qu’elles font à la veuë lorsqu’elles s’accordent bien ensemble.
Conceptual field(s)
Arresté. On dit un dessein bien arresté, lors que toutes ses parties sont bien desseignées, & recherchées, en sorte qu’il n’y a plus rien à retoucher. V. page 396.
Art. On dit une chose faite avec art & science, ou artistement faite.
Articulé. On dit d’une figure de relief ou de peinture, que les parties en sont bien articulées, bien prononcées.
Artistement. Une chose faite artistement, c’est-à-dire avec science, esprit & grande pratique.
Conceptual field(s)
Attelier, lieu où les Peintres, les Sculpteurs, & autres Ouvriers travaillent.
Attitude. Ce mot est Italien & veut dire la posture & l’action des Figures qu’on represente. Mais outre qu’il est plus general, & qu’il y a encore quelque chose de plus noble dans son expression, il y a des sujets où il est plus propre que les mots de posture & d’action, qui ne conviendroient pas si bien en parlant, par exemple, d’un corps mort. Les Italiens disent Attitudine.
Bleu artificiel dont on se sert en Peinture. Il est fait de sable, de sel, de nitre, & de limaille de cuivre. Vitruve enseigne cette composition l. 7. c. 11. mais la belle couleur bleuë qui est naturelle est faite de Lapis lazuli. V. Outremer.
Il y a une autre couleur bleuë qui se fait en Flandre, dont les Peintres se servent, mais qu’ils n’employent que dans les païsages, parce qu’elle verdit facilement, aussi l’appelle-t-on cendre verte.
Brosse, espece de pinceau fait de poil de cochon, dont les Peintres se servent.
Burin, c’est un outil d’acier avec lequel on grave sur le cuivre & sur les autres metaux. Il y en a de diverses sortes selon les ouvrages que l’on fait. Voyez page 388. Pl. LXI.
Cabinet. Le mot Cabinet a plusieurs significations, car il se prend quelquefois pour une armoire à serrer des papiers, ou d’autres sortes de hardes ; d’autres fois il signifie une petite piece d’un appartement qui peut servir à plusieurs usages.
Ainsi l’on appelle Cabinets les lieux que l’on orne de Tableaux, & que Vitr. L. 6. c. 5. Appelle Pinacotheca. […].
Calquer, c’est contre-tirer un dessein sur une muraille, ou autrement, pour en avoir les mesmes traits : cela se fait en frottant le dessous du dessein avec du noir ou d’autre couleur ; & ensuite avec une pointe qu’on passe dessus, on fait que la couleur marque sur la muraille ou autre chose qui est sous le dessein.
Quand au lieu de passer ainsi une pointe, on pique le dessein, & qu’après on le frotte avec du charbon en poudre, cela s’appelle poncer, & l’on nomme poncis les desseins qui sont piquez de la sorte, & qui servent plusieurs fois à faire de pareils ouvrages.
Camayeu. Lat. Cameus, les Joüaillers & les Lapidaires nomment Camayeus les Onyces, Cardoines, & autres pierres taillées de relief, ou en creux. Boot. de lap. l. 2. C. 85. C’est ce qui a donné lieu aux Peintres d’appeler Camayeus les Tableaux qui imitent ces sortes de pierres. Les Anciens nommoient ces peintures Monochromata.
Anciens (les)
BOËTIUS DE BOODT, Anselmus
Conceptual field(s)
Anciens (les)
BOËTIUS DE BOODT, Anselmus
Conceptual field(s)
Carmin, couleur dont on se sert à peindre en Miniature V. p. 418.
Conceptual field(s)
Carnation, c’est un mot general dont on se sert en Peinture pour exprimer la couleur de la chair, & toutes les parties d’un corps qui sont nües & découvertes.
Cartons. Les Peintres appellent ainsi les grands Desseins de papier qu’ils font pour peindre à Fraisque, & qui servent à calquer des Figures contre les murailles, comme aussi ceux que l’on fait pour des tapisseries, & autres grands ouvrages. V. p. 398.
Cartouches. Ce sont certains ornemens que l’on fait de Sculpture, de Peinture, &c. Ce mot vient de Charta, parce que les Cartouches representent des Rouleaux de Cartes coupées & tortillées. Leur premier usage estoit pour des inscriptions.
Champ, c’est le fond d’un Tableau ou d’une Medaille où il n’y a rien de peint ni de gravé.
On dit aussi qu’une draperie, ou un morceau de bastiment sert de champ à une Figure, quand la Figure est peinte sur la draperie, ou sur le bastiment.
Chargé. Les Peintres appellent un portrait chargé, lorsqu’on represente un visage avec des traits marquez avec excez, & de telle maniere qu’avec trois ou quatre coups de crayon ou autrement on connoist une personne, quoy que ce ne soit pas un veritable portrait, mais plustost des deffauts marquez. Aussi quand une Figure est trop marquée on dit qu’elle est chargée.
Clair-obscur. On appelle un Dessein de clair-obscur, un Dessein qui est lavé d’une seule couleur, ou bien dont les ombres sont d’une couleur brun, & les jours rehaussez de blanc. On nomme encore ainsi certaines Estampes en taille de bois, que l’on tire à deux fois. De mesme que des Peintures, ou des Tableaux qui ne sont que de deux couleurs, comme les frises de Polydore qui sont à Rome.
Quelquefois on dit le clair-obscur d’un Tableau, pour signifier seulement la maniere dont on a traité les jours, les demy-teintes, & les ombres, & avec laquelle on a sceu répandre la lumiere sur tous les corps. Ce sont deux mots dont l’on n’en fait qu’un à l’imitation des Italiens, qui disent Chiaro-scuro, V. p. 295.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Coloris. Ce mot se prend generalement pour toutes les couleurs ensemble qui composent un Tableau. Lorsqu’elles sont bien placées & bien entenduës l’on dit d’un ouvrage que le coloris en est beau.
Il est vray pourtant que cela s’entend plus particulierement des Tableaux d’histoires. Car on en dit point d’un païsage que le coloris en est beau, mais qu’il est bien naturel & bien entendu ; est mesme le mot de Coloris a plus de rapport aux carnations qu’à toute autre chose. V. p. 393.
Contourner quelque chose d’un costé & d’autre, c’est marquer une Figure avec des traits & des lignes.
On dit que les Contours sont beaux & bien proportionnez, lorsque dans les ouvrages de Peinture ou de Sculpture, les membres des Figures sont desseignez avec science & art, pour representer un beau naturel.
Contraste, c’est un mot dont les Peintres & les Sculpteurs se servent beaucoup, pour exprimer la diversité d’actions qui paroist dans leurs Figures, & la varieté qui se doit rencontrer dans la position & les mouvemens des membres du corps, & dans toutes les attitudes en general. C’est pourquoy ils disent, contraster, pour varier les actions & dispositions des Figures.
Contretirer un Dessein, ou un Tableau, c’est en prendre les mesmes traits, ce qui se fait d’ordinaire avec une toile de soye, ou du papier huilé qu’on applique contre le Tableau ; puis avec du crayon l’on marque sur le papier ou sur la toile, les mesmes traits du Tableau que l’on voit au travers de la toile ou du papier. On se sert aussi de verre, de talc, de vessies de pourceau, de boyaux de bœuf, de colle de poisson mise en feüilles, & d’autres matieres claires & minces pour contretirer des Ouvrages de moyenne grandeur.
Contretiré, qui est pris sur le mesme trait que l’original.
Conceptual field(s)
Contrepreuve, c’est une estampe qui est imprimée sur une autre estampe fraischement tirée. Cela se fait pour mieux voir s’il n’y a rien à retoucher à la planche, parce qu’on a par ce moyen la figure du mesme sens qu’elle est gravée.
Couleurs rompuës. Les Couleurs sont rompües lorsqu’elles ne sont pas employées toutes simples & pures, mais qu’on en mesle deux ou plusieurs ensemble pour en affoiblir & éteindre une trop vive ; Comme quand pour diminuer de la vivacité de la Laque, on y mesle un peu de terre verte ; ou bien, quand pour oster de l’éclat du Vermillon, on y mesle du brun rouge, soit en détrempant les Couleurs sur la palette, soit après qu’elles sont couchées sur la toile & en travaillant. Quand une draperie que est d’un jaune clair se trouve ombrée d’une laque obscure, on dit d’ordinaire que cette draperie est jaune rompuë de rouge. C’est pourtant mieux dit qu’elle est jaune ombrée de laque, si les deux couleurs sont separées : car le mot rompu ne se prend proprement que lors que la couleur n’est pas pure, mais meslée avec une autre. Enfin une couleur rompuë, parmy les Peintres, est celle que l’on esteint, & dont l’on diminuë la force ; ce qui sert beaucoup pour l’union & l’accord qui doit estre dans toutes celles qui composent un Tableau. Le Titien, Paul Veronese, & les autres Lombards s’en sont heureusement servis, comme l’a fort bien remarqué M. de Pile sur la poëme du sieur du Fresnoy. Les Italiens nomment cela Rottura de colori.
DE PILES, Roger
DU FRESNOY, Charles-Alphonse
École lombarde
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
VERONESE, Paolo (Paolo Caliari)
Conceptual field(s)
DE PILES, Roger
DU FRESNOY, Charles-Alphonse
École lombarde
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
VERONESE, Paolo (Paolo Caliari)
Conceptual field(s)
Bonnes Couleurs. Lors qu’on dit d’un Tableau, que les Couleurs en sont bonnes cela ne signifie pas pour l’ordinaire qu’elles soient d’une matiere plus exquise que celle d’un autre ; mais que le choix de la distribution, & la rencontre des unes auprés des autres, en est plus excellent.
Crayons pour desseigner, qui sont ou de craye blanche, ou de sanguine. On dit le premier crayon d’un Tableau, pour dire la premiere pensée, l’Esquisse, le premier dessein.
Crayonner, desseigner avec du crayon.
Degrader, c’est en terme de Peinture ménager le fort & le foible des jours, des ombres & des teintes selon les divers degrez d’éloignement.
Derober. Parmy les Peintres, lorsqu’on voit des Figures dans un Tableau prises & copiées d’après quelque ouvrage plus ancien, on dit qu’elles sont derobées d’un tel Maistre.
Desseigner. Lat. figurare, delineare, designare. Vitr. In. proem. l. 3. deformare. Il dit deformationes gramicae, au lieu de descriptiones & designationes quae per lineas fiunt. Car γραμμή signifie linea, comme dans son 5. l. c. 4. Il se sert de [grec], pour designatio, descriptio, figura.
Detacher. On dit d’un Tableau, que les Figures sont bien detachées, lorsqu’il n’y a point de confusion, qu’elles sont bien demeslées, qu’il semble que l’on peut tourner tout autour, & qu’elles paroissent de relief.
Conceptual field(s)
Detrempe. L’on peint à detrempe, lorsqu’au lieu d’huile on se sert d’eau avec de la colle. Voyez pag. 402.
Diligence. Il y a des Peintres qui pour imiter les Italiens disent qu’un tableau est fait avec diligence, pour dire avec soin, & qu’il est bien fini, car en cette rencontre le mot de diligence ne signifie pas promptitude.
Disposition. C’est une convenable situation de toutes choses, & un certain arrangement qui ne regarde pas les mesures & la quantité des parties de l’ouvrage, mais la qualité. Ainsi on dit qu’un Tableau est bien disposé, lorsque le sujet est bien représenté ; que toutes les Figures sont en leur veritable place, & font ce qu’elles doivent ; quoy que ces figures puissent estre mal proportionnées, & qu’il y ait beaucoup d’autres deffauts dans le reste de la composition.
Conceptual field(s)
Draperies. C’est un mot general dont les Peintres se servent pour exprimer toutes sortes de vestemens qui couvrent les Figures d’un Tableau. Car en parlant des Figures vestuës, on dit qu’elles sont bien drapées, que les draperies sont bien mises, ou bien entenduës, les plis bien agencez. Les Sculpteurs s’en servent aussi de mesme. Ils disent qu’une draperie est bien jettée ; qu’on morceau de draperie est bien disposé.
Dur, sec ; en terme de Peinture, c’est quand les choses sont trop marquées, soit par des traits trop forts, soit par des couleurs trop vives ou trop sombres proches les unes des autres, & lorsque le tout n’est pas desseigné & peint tendrement ou avec molesse & union. […].
Eloignement. Ce qui paroist de plus éloigné dans un Tableau, s’appelle d’ordinaire le lointain. On dit aussi les Figures qui sont dans l’Eloignement.
Emboire. On dit qu’un Tableau est embu, lorsque la couleur n’en paroist pas bien ; qu’il y a un certain mat qui fait que toutes les touches ne se discernent pas bien, & qu’il a perdu son luisant. Cela arrive à la Peinture à huile, & particulièrement lorsqu’elle est fraischement faite : demeurant souvent ainsi embuë jusqu’à ce que l’ouvrage soit bien sec, ou bien qu’on le fasse revenir en le frottant de vernix, ou de blanc d’œuf battu. Quand il y a trop d’huile dans les Couleurs, elles sont plus sujettes à s’emboire, particulierement sur les toiles nouvellement imprimées de longue main, ou sur de vieilles ébauches, dont la couleur est bien seiche, ne s’emboivent pas. V. p. 405.
Conceptual field(s)
Empasté. On dit un Tableau bien Empasté de couleurs, c’est-à-dire bien nourry de couleurs, & qui soient mises épaisses ; mais couchées uniment. V. p. 409.
Encre. Il y en a de diverses sortes, sçavoir, pour écrire, pour les Imprimeurs de livres, & pour ceux qui impriment les Estampes. Il y a encore l’Encre de la Chine, qui sert à écrire & à laver.
Conceptual field(s)
Enluminer les Estampes, c’est les laver avec des couleurs à gomme.
Entente. On dit d’un Tableau que l’Ordonnance y est bien entenduë ; qu’il est conduit avec beaucoup d’entente, soit pour la disposition du sujet, soit pour les expressions, soit pour les jours & les ombres. V. p. 395.
Equilibre : quand une Figure de relief ou de Peinture n’est pas bien posée, on dit qu’elle n’est pas dans son Equilibre.
L’Equilibre ou Ponderation est une partie considerable dans la Peinture, & dans la Sculpture, pour sçavoir bien poser les Figures sur leur centre de gravité, afin qu’elles soient fermes, & qu’elles ne semblent pas tomber ou porter à faux.
Esleve, ce mot est particulier aux Apprentifs & Disciples des Peintres. Ainsi Jules Romain, Perin, del Vague, &c. estoient Esleves de Raphaël. Il vient de l’ital. Allievo.
Espargner. […] En Peinture, Espargner veut dire ne point toucher à quelque chose, comme, on dit qu’il faut coucher le Ciel d’un Tableau, & espargner les figures & les bastimens, c’est-à-dire ne rien coucher dessus.
Esquisse, du mot ital. Squizzo qui est une legere esbauche ou le premier crayon de quelque pensée & de quelque ouvrage qu’on medite de faire. Et parce que les Ouvriers font ces premiers desseins avec furie & promptitude d’esprit, & en peu de temps, les Italiens ont nommé cela Squizzi, de Squizzare, qui veut dire sortir dehors, & jalir avec impetuosité.
Estampe, de l’Ital. Stampare, qui veut dire imprimer. Les Peintres nomment Estampes toutes les pierres gravées à l’eau forte, au burin & en bois. Les Marchands & le vulgaire les appellent Images ; & celles qui sont sur le cuivre, Tailles-douces.
Estamper, Imprimer.
Eurythmie. C’est une apparence majestueuse, & ce je ne sçay quoy d’aisé & de commode, qui paroist dans la composition de tous les membres d’un corps, & qui résulte de leur belle proportion.
Figure, c’est un terme general qui signifie Image ou representation de quelque chose que ce puisse estre. Mais parmy les Peintres ce mot est ordinairement pris pour des Figures humaines, ainsi l’on dit qu’un Tableau est remply de Figures, lorsqu’il y a plusieurs Personnages ; & qu’un païsage est sans Figures, lors qu’il n’y a que des Arbres.
Conceptual field(s)
Finir un tableau, c’est l’achever en toutes parties. Un Tableau ou un Dessein bien achevé, bien finy. On dit aussi, particulierement dans la Peinture en Esmail, qu’il y a un grand finiment.
Conceptual field(s)
Flou ; C’est un vieux mot dont autrefois on se servoit pour exprimer en termes de Peinture, la tendresse & la douceur d’un ouvrage. Il vient peut-estre de Fluidus ; ou de Floüet, qui veut dire tendre, molet, ou delicat.
Fond, Derriere ou Champ d’un Tableau ; Ce mot signifie souvent en peinture la partie au dessous d’une autre. Ainsi on dit que le Ciel fait fond à un arbre ; qu’une montagne fait fond à une maison, ou à des Figures ; qu’une draperie sert de fond à la teste, ou au bras de quelque Figure.
Force. En terme de Peinture on dit, un tableau qui a beaucoup de force, & de relief.
Conceptual field(s)
Forcé, une figure dont l’attitude est contrainte & forcée.
Fraisque, ou Fresque. On appelle peindre à Fraisque lorsqu’on peint sur un enduit de mortier tout frais, avec des couleurs détrempées seulement avec de l’eau. Vitr. l. 7. c. 3. appelle udo tectorio, ce que les italiens disent à Fresco. V. p. 397.
Franchise. On dit franchise & liberté de pinceau, ou de burin, c’est-à-dire un travail facile, & fait avec art.
Galerie d’une maison, que l’on orne de Tableaux & de Statües ; c’est ce que les Anciens nommoient Pinacotheca.
Gomme. Il y a differentes sortes de Gommes ; la Gomme Gutte fait une couleur jaune qui sert pour peindre en Miniature. L’on y employe aussi de la Gomme Adragant, & de la Gomme Arabique, mais elles n’ont pas de couleur, & servent seulement à faire tenir les couleurs sur le velin, ou sur le papier.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Goust ; en Peinture, c’est un choix des choses que le Peintre represente, selon son inclination, & la connoissance qu’il a des plus belles & des plus parfaites. Lorsqu’il connoist, & qu’il exprime bien dans ses ouvrages ce qu’il y a de plus beau dans la Nature, on dit que ce qu’il fait est de bon goust. Et s’il ignore en quoy consiste la beauté des corps, & qu’il ne les represente pas selon la belle Idée que les anciens Peintres & Sculpteurs ont euë, on dit que cela n’est pas d’un bon goust, & de bonne maniere ; parce que la bonne maniere dépend en premier lieu du choix qu’on sçait faire des sujets, & des personnes qu’on se propose d’imiter. Le mot de Goust a une mesme signification dans la Sculpture, & dans les autres Arts qui dépendent du Dessein.
Graces, en terme de Peinture, on dit donner de la grace aux Figures ; Figures gracieuses.
Conceptual field(s)
Graticuler une toile pour peindre dessus ; c’est la diviser par petits quarrez ou autrement, afin qu’en formant de pareils quarrez ou figures sur le Tableau ou Dessein qu’on veut copier, on puisse disposer plus facilement tout le sujet ; en proportionner mieux les Figures, & reduire plus aisement, le tout de grand en petit, ou de petit en grand. On se sert quelquefois d’un chassis divisé par quarreaux qu’on applique sur le Tableau, pour n’avoir pas la peine d’y tracer tant de traits. V. pag. 414. Pl. LXXVI.
Conceptual field(s)
Graver sur le cuivre & sur les autres metaux ; ce qui se fait en differentes manieres, soit avec burins, eschopes ou autrement.
Grottesque ; c’est une maniere licentieuse de representer en Peinture, ou de relief, des hommes & des bestes qui ont quelque chose de Chimerique, & qui d’ordinaire n’en ont que la teste & une partie du corps dont le reste se termine en feuillages, rinceaux, ou autrement. On nomme ces sortes d’ouvrages Grotesques, à cause que l’invention en est venuë de ceux qu’on a trouvez dans les Grottes & lieux souterains. Jean da Udine, & Morto da Feltro Peintres Italiens, ont esté les premiers, qui à l’imitation des Anciens, ont remis en usage cette sorte de travail, qui n’est qu’un pu caprice de l’esprit de l’Ouvrier.
Anciens (les)
DA FELTRE, Morto (Pietro Luzzo)
DA UDINE, Giovanni
Conceptual field(s)
Groupe ; C’est un assemblage de plusieurs corps les uns auprés des autres. L’on dit un groupe de trois ou quatre Figures, lorsqu’elles se joignent. On dit aussi un groupe d’animaux ; un groupe de fruits ; ce qui s’entend des Ouvrages de Sculpture, comme de ceux de Peinture. Car le Laocoon antique est un Groupe de trois belles Figures. Ce mot vient de l’Italien Groppo.
Histoire parmy les Peintres. Il y en a qui s’occupent à representer diverses choses. Comme des Païsages, des Animaux, des Bastimens, & des Figures humaines. La plus noble de toutes des especes est celle qui represente quelque Histoire par une composition de plusieurs figures. Et ces sortes de Peintures s’appellent Histoire. C’est de que Vitr. Nomme Megalographia, c’est-à-dire, une Peinture d’importance.
Horizon. Dans un Tableau la ligne horizontale, est celle où est le point de veuë, auquel toutes les autres lignes des costez doivent aboutir pour mettre les corps en perspective.
Image. On dit l’Image d’un Saint ; mais d’ordinaire on ne dit pas l’Image du roy, ny l’Image d’un tel, on dit son Portrait ; Et lorsque c’est de la Sculpture, on dit sa Figure, sa Statuë. Cependant les Anciens se servoient indifferemment du mot Imago. Car quand Vitr. l. 6. c. 4. fait mention des Portraits de cire dont ils ornoient les Vestibules de leurs maisons, il employe le nom d’Images, & non pas de Statuës ; parce que c’estoit les Portraits au naturel de leurs Ancestres, qu’il estaloient ordinairement dans ces lieux-là, non pas d’autres Statuës indifferentes. Mais parmy nous le nom d’Image semble estre consacré aux choses saintes.
Le mot d’Image signifie aussi parmy le peuple toutes sortes d’Estampes.
Anciens (les)
VITRUVIUS
Conceptual field(s)
Anciens (les)
VITRUVIUS
Conceptual field(s)
Imiter. Quand on dit qu’il faut imiter l’Antique, ou la maniere d’un tel Maistre, ce n’est pas copier trait pour trait ce qui est desseigné ou peint, ou ce qui est de Sculpture, mais c’est se former une Idée semblable, & suivre la mesme maniere.
Imprimer. On dit Imprimer une toile, ou autre chose pour peindre, lorsqu’on couche une premiere, couleur qui sert de fond à celle qu’on doit mettre en suite, pour faire un tableau. Les Ouvriers disent Imprimeure, & quelques-uns mal-à-propos Imprimature, pour imiter les Italiens qui disent Imprimatura.
Inde ; c’est une couleur qui sert pour peindre. Les Anciens en avoient de deux sortes selon Pline l. 35. c. 6. & Discoride l. 5. c. 57. L’une qui se faisoit avec de certains roseaux qui se trouvaient aux Indes ; l’autre de l’escume des chaudieres où l’on teint les draps de pourpre. L’Inde qu’on employe aujourd’hui se fait aussi de deux manieres, l’une du suc d’une herbe que les Grecs nomment Isatis, & les Latins Glastum, que nous appellons Guesde ; Et l’autre de l’herbe appellée Indigo, qui croist dans la Province de Gatimala, & ce qui est de grand usage parmy les Teinturiers V. p. 411.
Invention, dans un Tableau, c’est ce qui est purement de l’esprit du Peintre ; comme sont l’ordonnance, la disposition du sujet, & le sujet mesme quand il est nouveau. Bien inventé, c’est-à-dire bien trouvé, soit que cela regarde tout le sujet, soit qu’on ait égard à la maniere de le traiter en tout, ou en partie.
Conceptual field(s)
Jour. En Peinture on dit, les jours, pour dire les parties éclairées.
On dit qu’un Tableau est mal placé, & dans un faux jour, lorsque la lumiere qui entre par les fenestres, ne l’éclaire pas bien.
On considere aussi dans une peinture les differents Jours que le Peintre y a observez, comme les Jours simples & naturels ; les Jours de reslais, ou reflechis.
Juste ; Un dessein juste & conforme à l’original, desseigner juste ; des contours justes, marquez avec justesse, force & netteté.
Laque. Il y a une espece de gomme que les Droguistes nomment Laque ; Les Arabes, les Perses, & les Turcs l’appellent Loc fumutri. Cette gomme est un peu rougeastre ; l’on en fait la cire d’Espagne ; elle entre dans la composition du Vernix, & sert à plusieurs autres usages. La commune opinion est qu’elle se trouve au Peru, où il y a une espece d’arbres, desquels certaines grandes fourmis qui ont des ailes, succent & tirent la matiere dont elles font la Laque, comme les Abeilles font le miel. Il y en a qui croyent que la Laque est la Cancame de Dioscroride. On peut voir ce qu’en a écrit Charles de l’Escluse dans son histoire des Drogues l. 1. c. 9. & Christophe Acosta dans un traité de Medecine l. 3. c. 3.
ACOSTA, Cristobal
CLUSIUS, Carolus (Charles de L'Escluse)
Conceptual field(s)
Lavis ; il y en a de differentes sortes. V. p. 397.
On dit qu’on dessein est lavé ou fait avec du Lavis, c’est-à-dire d’une ou de plusieurs couleurs détrempées avec de l’eau. Neanmoins quand on dit simplement un dessein lavé, on entend souvent qu’il n’y ait qu’une seule couleur, comme d’encre de la Chine, du bistre, ou autre chose.
Lescher. On dit un Tableau lesché, dont les couleurs sont couchées avec plus de soin & de peine, que d’art & de science.
Liberté. En terme de Peinture, on dit d’un Tableau, qu’il est peint avec une grande liberté de pinceau desseigné librement, franchement. On dit aussi liberté ou franchise de burin. Tout cela veut dire avec facilité.
Licenses. On dit d’un Tableau, qu’il y a de grandes licences contre la perspective, & contre les regles de l’art.
Ligne. C’est ce que les Mathematiciens definissent une longueur sans largeur, & que les Ouvriers appellent un trait qui va d’un point à un autre. Il y en a de plusieurs especes : les lignes droites sont les plus courtes de celles qui s’écartent de leurs extremitez. Les courbes sont celles qui s’écartent de leurs extremitez. Les spirales sont des lignes courbes, qui partant de leurs centres s’éloignent à proportion qu’elles tournent au tour. La ligne perpendiculaire est celle qui tombe ou qui s’élève sur une autre, faisant les angles de part & d’autre égaux entr’eux. La ligne à plomb est celle qui tombe de haut en bas sans incliner de part ny d’autre, & qui passeroit par le centre de la terre si elle estoit prolongée. Les lignes paralelle sont celles qui prolongées à l’infiny ne se rencontreroient jamais. Lignes horisontales sont toutes celles qui sont paralelles a l’horison. Et la ligne oblique est celle qui n’est ny horisontale, ny à plomb.
Lointain, ou éloignement d’un Tableau ; c’est ce qui paroist le plus loin de la veuë. Comme quand on dit, on voit dans le lointain de ce Tableau plusieurs petites figures.
Mannequin ; C’est une figure de bois dont les Peintres & sculpteurs se servent pour disposer des draperies suivant les diverses attitudes des figures qu’ils veulent peindre. Ces mannequins s’accommodent comme on veut, se ployant dans toutes les jointures des membres.
Maniere. On appelle ainsi l’habitude que les Peintres ont prise dans la pratique de toutes les parties de la Peinture, soit dans la Disposition, soit dans le Dessein, soit dans le Coloris.
L’on se fait d’ordinaire une habitude qui a rapport aux Maistres sous lesquels on a esté instruit, & qu’on a voulu imiter. Ainsi on connoist la maniere de Michel-Ange, & de Raphaël dans leurs Eleves. Ce qui fait dire en voyant un Tableau de quelques-uns de leurs disciples, qu’il est de l’Ecole de Raphael ou de Michel-Ange, parce que ces deux grands Maistres ont eu des maximes differentes, que ceux qui les ont imitez ou suivies. Et selon qu’un Peintre s’est formé dans une bonne habitude en travaillant sous de bons maistres, ou par une étude particuliere qu’il a faite luy-mesme après les meilleurs Tableaux & les plus belles Antiques, on appelle sa maniere bonne, ou mauvaise, s’il a fait un bon, ou mauvais choix.
Comme l’on reconnoist le style d’un Auteur, ou l’écriture d’une personne dont on reçoit souvent des lettres, on reconnoist de mesme les ouvrages d’un Peintre dont on a veu souvent des Tableaux ; & on appelle cela connoistre sa maniere. C’est pourquoy il y a plusieurs personnes, qui pour avoir veu beaucoup de Tableaux ; connoissent les differentes manieres, & en nomment aussi-tost les Auteurs ; mais qui pour cela n’en sont pas les plus sçavans, ny capables de bien juger de l’art & de la science de l’Ouvrier.
Megalographie. C’est un mot dont il n’y a que Vitruve l. 7. c. 5. qui se soit servy pour signifier des Peintures magnifiques, telles que sont les sujets qui traitent de l’Histoire ; de mesme que Ryparographie veut dire des Peintures viles & des sujets bas, tels que sont les animaux, des fruits, & autres.
Membre. On dit en terme de peinture parlant d’une Figure, que tous les membres en sont beaux & bien proportionnez : Toutes les parties bien articulées ; les contours corrects, & bien prononcez […].
Menager. En terme de peinture on dit menager ses couleurs ; Menager ses teintes ; c’est conserver les plus fortes & les plus claires pour les parties les plus proches, & pour les rehauts.
Mine, couleur pour peindre. Elle est faite de ceruse brûlée dans une fournaise. Pline la nomme Usta ; Vitruve l. 7. c. 12. Sandaracha. Serapion, Minium ; & les Droguistes, mine de plomb. Sa couleur est d’un rouge orangé fort vif. L’on ne s’en sert guere dans les Tableaux. V. p. 411. 250.
Miniature ; c’est une maniere de peindre sur le velin avec des couleurs tres-fines, détrempées avec de l’eau de gomme. On dit peindre en miniature ; un portrait de miniature ; un ouvrage de miniature. Voyez p. 418.
Modelle. Les Peintres & les Sculpteurs nomment modelle tout ce qu’ils se proposent d’imiter. C’est pourquoy dans l’Academie de Peinture, & de Sculpture, on nomme Modelle celuy qui s’expose tout nud devant les Escoliers, pour desseigner d’après luy. […]
Mais on n’appelle pas modelle, le premier dessein ou esquisse d’un Tableau ; on dit le dessein, quoy que les Peintres disent qu’ils ayent eu pour modelle tels ou tels ouvrages.
Conceptual field(s)
Molette dont l’on se sert pour broyer les couleurs ; c’est une pierre de marbre, de porphyre, d’escaille de mer, ou autre. Les Italiens l’appellent, il macinello. V. p. 413. 414. Pl. LXII.
Moresques, & Arabesques, ce sont certains rinceaux d’où sortent des feuillages qui sont faits de caprice, & d’une maniere qui n’a rien de naturel, on s’en sert d’ordinaire dans les ouvrages de damasquinerie, & dans quelques ornemens de peinture, ou de broderie.
Mouelleux, terme dont on se sert en Peinture pour exprimer la tendresse qui se rencontre soit dans les carnations, soit dans les draperies, quand il n’y a rien de trop sec, & qui tranche dans le dessein, & dans les couleurs.
Nud ; en terme de Sculpture & de Peinture, on dit, le nud d’une Figure, pour parler de ce qui n’est pas couvert de draperie. On dit aussi les nuditez d’un Tableau, pour exprimer en gros que des Figures sont découvertes ; Mais lorsqu’en Peinture on veut marquer en particulier ce qu’il y a d’art & de beau dans le nud des Figures, ont dit que les carnations en sont belles. […].
Ochre, du mot ὤχρα, couleur pasle. Noux appellons Ochre une terre jaune dont les Peintres se servent, & que les Italiens nomment terra gialla.
On appelle aussi Ochre rouge la terre rouge, qui souvent est une mesme matiere que l’Ochre jaune. La rouge est ordinairement plus proche de la surface de la terre, & semble avoir pris cette couleur plus forte de la chaleur du Soleil qu’elle reçoit plus aisément que l’autre qui est dessous. Aussi en calcinant l’Ochre jaune on luy donne une couleur rouge. Les Anciens employent le Sil, qui estoit aussi de couleur jaune, & une espece de limon qui se touvoit dans les mines d’argent. Pline l. 33. c. 12 & 13. Il y a apparence que le Sil & l’Ochre n’estoient qu’une mesme matiere, le premier estant le nom latin, & l’autre le nom grec. On peut voir Vitruve l. 7. c. 7. V. p. 250.
Optique ; c’est une science qui fait partie de la Mathematique, & qui traite des choses qui appartiennent à la veuë. Elle est tres-necessaire aux Peintres & aux Sculpteurs.
Original. On dit d’un tableau qu’il est original quand ce n’est point une copie faite sur un autre. Les ignorans croyent avoir assez estimé un ouvrage quand ils ont dit qu’il est original, ne sçachant pas qu’un Peintre mal-habile peut faire de fort mauvais originaux.
Outre-mer. Ital. Oltra marino. Cette couleur tres necessaire aux Peintres, est ainsi nommée parce qu’elle vient du levant. Elle estoit fort rare & chere avant qu’on est sceu en Italie & icy le moyen de broyer & bien mettre en poudre le Lapis Lazuli dont elle est faite. Mais la maniere de le bien faire est à present assez commune ; ce qu’il y a de facheux, c’est que la plus part de ceux qui travaillent à le broyer, & l’avarice des marchands le falsifient en meslant de l’Esmail parmy. Les Peintres pourtant ont un secret pour connoistre cela. Il y a apparence que les Anciens ne s’en servoient pas, puisque Vitruve, qui parle de la couleur bleuë dans le II. c. de son 7. livre n’en dit rien, & qu’il enseigne la composition du bleu artificiel dont l’on se servoit en ce temps-là. V. p. 400.
Paisages. Les tableaux qui representent la campagne, & ou les figures ne sont que comme des accessoires, s’appellent païsages, & ceux qui s’appliquent particulierement à ce travail Païsagistes. Les Peintres prononcent paisage, ne faisant qu’une sillabe des deux premieres voyelles. Vitruve. l. 7. c. 5. nomme les païsages Topia.
Pastels ; Ce sont des crayons composez de differentes couleurs que l’on broye, & dont l’on fait une paste detrempées avec de l’eau de gomme & un peu de plastre pour donner plus de corps. On mesle les couleurs ensemble selon les diverses teintes qu’on veut faire. C’est de ces sortes de crayons dont les Peintres se servent pour travailler sur du papier, & faire des portraits ou autres choses qui semblent estre peints, mais qu’il faut couvrir d’un verre pour les conserver.
Conceptual field(s)
Patronner en terme de peinture ; c’est lorsque par le moyen d’un papier ou d’une carte decoupée & à pieces emportées qu’on applique sur une toile ou sur autre chose, on imprime avec de la couleur les figures qui sont enlevées sur la carte de la mesme maniere que font les faiseurs de carte à jouer, qui ont differens patrons pour patronner les figures & y mettre les couleurs.
Peint. On dit peint & non pas peinturé, comme quelques-uns l’escrivent. Car par le mot de peinturé, l’on ne pourroit entendre qu’une chose couverte d’une seule couleur, comme quand on imprime & que l’on couche tout à plat un plancher d’une couleur jaune ou rouge. Mais le mot de peint s’estend plus loing qu’à couvrir de couleur ; il signifie l’art, la beauté du travail, & le maniement du pinceau. Ainsi l’on dit d’un portrait qu’il est bien peint, pour dire bien travaillé en ce qui regarde la Couleur.
Peintre. Pictor. Vitr. l. 7. ch. 10. appelle Tectores tous les ouvriers qui travaillent tant à faire les enduits des murailles qu’à les peindre, comme font ceux que nous appellons des Imprimeurs & qui font de grosse besogne.
Perdu. On dit d’une figure peinte que les contours en sont perdus ou noyez, lorsqu'ils sont confondus avec le fond.
Perspective ; C’est ce que Vitruve nomme scenographia, c’est-à-dire la face & les costez d’un edifice & de toutes sortes d'autres corps.
La Perspective pratique consiste en trois lignes principales ; la première est la ligne de terre ; la seconde la ligne horizontale où est toujours le point de veüe ; la troisiéme la ligne de distance, qui est toujours paralelle à la ligne horizontale, cette partie est tres-necessaire aux Peintres.
On appelle particulièrement Perspectives les tableaux qui sont faits pour representer des bastimens en perspective, c'est-à-dire tracez dans toutes les regles, & conduits par lignes & diminution de couleurs. On appelle perspective lineale la diminution des lignes, & Perspective aerienne la diminution des teintes & des couleurs.
Pied. On dit un tableau reduit au petit pied, quand pour en copier un grand on en proportionne toutes les parties par quarrez, suivant ceux qu’on a marquez sur l’original ; c’est ce qu’on nomme aussi graticuler, ou faire un chassis, ou treillis.
Pierre à broyer les couleurs. Les meilleures & les plus dures sont de porphyre, ou d’escailles de mer, qui est une pierre tres-dure & propre à cela.
Porte-Crayon pour desseigner. Voyez p. 414. Pl. LXII.
Portraire. Le mot de Portraire est un mot general, qui s’estend à tout ce qu’on fait lors qu’on veut tirer la ressemblance de quelque chose ; neamoins on ne l’employe pas indifferemment à toutes sortes de sujets. On dit le Portrait d’un homme ou d’une femme ; mais on ne dit pas le portrait d’un cheval, d’une maison la figure d’un arbre. Ce n’est pas mesme un terme bien receu parmy les sçavans Peintres de dire qu’on va se faire portraire, & moins encore celuy de se faire tirer, que la plus part des gens qui ne font pas de l’art disent ordinairement. On dit plustost un tel se fait peindre par un tel, ou bien, fait faire son portrait. On ne dit guere aussi faire un portrait de Sculpture, on dit faire la statuë d’un tel ; se faire representer en marbre ou en bronze. On ne nomme jamais un Tableau d’histoire, & qui est composé de plusieurs Figures, un Portrait. On peut bien dire qu’il y a dedans le portrait d’un tel, pour dire son image ou la ressemblance au naturel.
Conceptual field(s)
Poser un modelle, c’est à dire placer une personne afin de desseigner d’après, comme l’on fait dans l’Academie de Peinture. On dit aussi une Figure bien posée.
Posture, ce mot ne se dit guere parmy les Peintres sçavans. On dit l’attitude, l’action, la disposition.
Profil ; C’est le contour de quelque figure.
On dit profiler pour dire desseigner seulement les contours de quelque chose que ce soit.
On dit, le profil d’un visage ou d’une teste lorsqu’on en voit que la moitié & un des costez. Quoyque le mot de profil soit general pour exprimer tous les contours d’un corps, neanmoins en peinture l’on ne s’en sert pas d’ordinaire, on dit desseigner ou contourner ; & lorsqu’on parle d’un profil, on entend ordinairement un visage qui ne se voit qu’à moitié.
Prononcer, en terme de peinture ; C’est marquer & specifier les parties de toutes sortes de corps avec autant de force & de netteté qu’il est necessaire pour les rendre plus ou moins distinctes. Ainsi les Peintres, en parlant d’un tableau, disent que certaines parties en sont bien prononcées ; qui est une marque metaphorique de s’enoncer ; Comme lorsqu’on dit d’un homme qui parle bien, qu’il a une belle prononciation ; ce que M. de Piles a fort bien remarqué dans ses notes sur le poëme du sieur du Fresnoy.
Proportion ; Rapport d’une chose à une autre avec une convenance du tout aux parties. On dit une Figure bien proportionnée, un Edifice où toutes les proportions sont bien gardées. V. Symmetrie.
Conceptual field(s)
Quadre. On appelle ainsi toutes les bordures quarrées qui enferment quelque ouvrage soit de sculpture soit de peinture, ou autres choses, de quelque matieres qu’ils puissent estre ; Ce n’est pas qu’à l’égard des bordures rondes, ovales ou d’autres figures, on n’employe aussi ce mot abusivement. Car on nomme indifferemment Quadre la bordure ou la corniche qui environne un tableau. Outre que les Quadres servent d’ornement aux tableaux ; ils contribuent encore à les faire paroistre davantage. Aussi les marchands & les Curieux affectent de ne montrer jamais leurs tableaux, s’ils ne sont dans des bordures, afin qu’ils fassent un plus bel effet ; C’est pourquoy les italiens disent qu’une belle bordure qu’ils nomment corniche, est il Rufiano del quadro ; car parmy eux le mot de quadro est pris pour tableau. V. p. 172. 176. Pl. XXVIII.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Retoucher, on dit retoucher un Tableau qui a esté gasté, ou bien encore on dit qu’un Tableau n’est que retouché d’un tel maistre qui l’aura fait peindre sur ses desseins par son Eleve ; ou bien c’est une copie retouchée par celuy qui a fait l’original, ou par un bon maistre.
Revestir, on dit revestir pour environner ; comme revestir un modelle de cire avec de la terre ou autre chose.
On dit aussi, en terme de Peinture & de Sculpture, revestir ou vestir une Figure.
Conceptual field(s)
Reussite. Les Peintres disent d’un tableau bien executé, qu’il y a une heureuse reüssite.
Sanguine, c’est une pierre rouge dont l’on fait des crayons pour desseigner. C’est la pierre ematite dont Pline parle au 20. ch. de son 36. livre & dit qu’il y en a de cinq especes. […].
Conceptual field(s)
Stil de Grun ou Grain ; c’est une couleur pour peindre. Ce mot vient peut-estre du Flamant Schytgel, qui signifie une couleur jaune : ou bien de l’Anglois Grain, qui signifie vert. Car la graine, dont on fait cette couleur, qu’on appelle vulgairement graine d’Avignon, fait du vert & du jaune.
Symmetrie. M. Perrault dans ses notes sur le 2. Chap. du 1. Liv. de Vitruve, & sur le 1. ch. du 3. liv. a parfaitement bien observé que le mot de Symmetrie, de la maniere que nous en usons d’ordinaire en françois, ne signifie point ce que Symmetria signifie en Grec & en Latin ; ny ce que Vitruve veut dire dans ce Chapitre, qui est le rapport que la grandeur d’un tout a avec ses parties, lorsque ce rapport est pareil dans un autre tout, à l’égard aussi de ses parties où la grandeur est differente. Car par exemple, si deux Statuës se rencontrent, dont l’une ait huit pieds de haut, & l’autre huit pouces ; Et que celle qui n’a que huit pouces, ait la teste d’un pouce de haut ; comme celle qui a huit pied, a la teste d’un pied ; On dit que ces deux Statuës sont de mesme Proportion, & non pas de mesme Symmetrie. Parce que Symmetrie en françois a un autre signification, & veut dire le rapport que les parties droites ont avec les gauches, & celui que les hautes ont avec les basses, & celles de devant avec celles de derriere. &c.
Conceptual field(s)
Teintes, Demy-Teintes, ce sont termes de Peinture, pour exprimer les diverses couleurs, selon qu’elles sont plus claires ou plus brunes, ou plus vives ou plus tuées.
Tendre ; c’est en terme de Peinture & de Sculpture le contraire de dur & de sec, on dit cela est peint ou travaillé tendrement.
Tendresse, il y a beaucoup de tendresse dans ces plis, tout est peint avec beaucoup de tendresse & de douceur.
Terni ; on dit un Tableau terni, dont les couleurs sont passées.
Theorie θεωρία, Contemplation, Consideration. L’on dit qu’une personne n’a que la Theorie d’un art, lorsqu’il n’en a pas la pratique, & qu’il n’est pas Ouvrier.
Toile graticulée ou craticulée pour reduire un tableau au petit-pié. V. p. 191.
Torche-Pinceau ; c’est un petit linge que sert aux Peintres à essuyer leurs pinceaux & leur palette.
Tourmenter les couleurs ; c’est lorsqu’en peingnant on les manie trop avec le pinceau ou la brosse.
Traitter noblement un sujet dans un Tableau, c’est-à-dire le representer avec grandeur, & dans toutes les circonstances de l’histoire qu’on veut peindre.
Conceptual field(s)
Tramontains. Les Italiens appellent Peintres Tramontains les Peintres estrangers, particulierement ceux d’Allemagne & de Flandre, à cause qu’ils habitent au delà de leurs montagnes.
Travail. L’on dit en Peinture, voila un beau travail, pour exprimer la beauté de l’execution.
Conceptual field(s)
Trempe ou detrempe, Ital, Tempera maniere de peindre. Les Italiens nomment particulierement peindre à trempe, lorsqu’ils se servent seulement de jus de figuier & de blanc d’œuf, au lieu de cole. V. p. 402.
Verd, couleur. Il y a diverses sortes de verds dont l’on se sert en peinture selon la maniere du travail ; car il y en a qui sont propres à huile, qui ne sont pas bons à fraisque ou a détrempe. L’on en compose avec des sucs d’herbes pour peindre en miniature. Celuy que l’on fait avec de la fleur de flambe ou iris est fort beau. Les Italiens le nomme verdigiglio. V. p. 412-418.
Vermillon ou Cinabre. Le Cinabre mineral appellé minium dont les Peintres se servoient anciennement, estoit une couleur en forme de pierre rouge, qui se tiroit des mines de vif argent, Vitr. liv. 7. ch. 8. Le Vermillon que nous employons aujourd’huy, & qu’on nomme Cinabre artificiel tient lieu aux Peintres de l’ancien Minium, qu’on estime n’estre pas si beau que celuy d’apresent que l’on fait avec le souffre & le vif argent. Il y a encore une autre couleur rouge que Serapion appelle Minium, & les droguistes Mine de Plomb. Elle se fait avec de la ceruse bruslée, Pline l’appelle usta, qui est aussi le nom de l’ocre bruslé. V. Mine & p. 411.
Vernis, il s’en fait de plusieurs sortes, pour vernir les tableaux, les principales drogues qu’on y employe sont la therebentine & le sandarax. Voyez page 413.
Union de couleurs. On dit qu’un tableau est peint avec une belle union de couleurs, quand elles s’accordent bien toutes ensemble, & à la lumiere qui les éclaire ; qu’il n’y en a point de trop fortes qui detruisent les autres, & que toutes les parties sont si bien traittées, que chaque chose fait bien son effet.